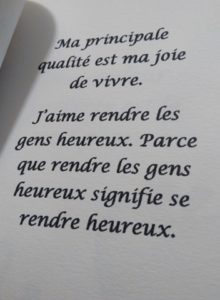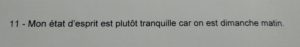Dans les gris de novembre et du monde, il est difficile d’apercevoir les couleurs. Aucune nuance ou si peu. C’est souvent ainsi mais nul doute que cette année, la noirceur semble estomper la lumière.
Alors, peut-être pourrais-je essayer d’en poser ici des couleurs, celles que j’attrape d’un regard, celles que je touche du doigt, celles qui embaument un peu l’espace de mes jours. Au fil de novembre et avant un Avent de possible douceur. 😉
Un rond de soleil
J’ai travaillé toute la journée.
Me replonger dans la poésie pour mes 3è, dans des contes merveilleux pour mes 6è, dans des montages audio pour mes latinistes. Oh… qu’elles m’ont fait du bien ces heures à lire, chercher et écouter à nouveau leurs voix ! Oui, qu’elles m’ont fait du bien. Je ne voulais plus rien entendre du monde. Rien. Surtout pas tous ces profs qui ne cessent de tempêter contre un pouvoir qu’ils critiquent mais dont ils attendent Tout pendant que mon petit collège silencieux – et beaucoup d’autres comme lui je le sais – travaille d’arrache-pied ce vendredi de vacances pour prendre à bras-le-corps le retour des élèves et leur préparer un temps de parole et d’écoute. Et c’est prêt. Et cela se fera, comme d’habitude, à la seule force de notre bienveillance, de notre imagination et de notre temps donné.
J’ai travaillé toute la journée.
Par la fenêtre de mon bureau, le noir du ciel annonçait la pluie. Je l’ai aperçu lui aussi, cherchant à occuper son temps ailleurs que derrière son écran, ramassant les feuilles mortes, allégeant la terre de son potager, sciant les rondins pour le feu qui bientôt nous réchaufferait. Oh… qu’il m’a fait du bien son sourire, son clin d’œil par la fenêtre ! Oui qu’il me fait du bien. Je ne voulais plus entendre les cris du monde. Plus aucun. Surtout pas tous ces gens qui savent mieux que personne ce qu’il faut dire ou ce qu’il faut penser quand je ne sais pas ce qu’il faut répondre au mal, quand je ne sais que les larmes et si peu la colère, quand je crois seulement au verbe aimer.
J’ai travaillé toute la journée. J’ai rempli l’espace de mon temps pour oublier.
Mais rien ne s’est vraiment apaisé.
Puis l’heure s’est approchée. Celle qui mène doucement mes pas vers la cuisine. Celle où je travaille autrement de ma tête et de mes mains.
J’ai fait bouillir l’eau, jeté le riz en pluie, mélangé le lait à la crème et aux raisins blonds, laissé frémir le dessert à petits bouillons.
J’ai attrapé le potiron, caressé un peu ses joues dodues et orangées, coupé sa chair en morceaux. J’ai préparé une soupe à la douceur du velouté en ajoutant quelques herbes, un peu de crème encore. Les odeurs se sont entremêlées, parfums prometteurs d’une belle fin de journée. Un rayon de soleil par la fenêtre a percé les nuages. J’ai sorti les assiettes et dressé joliment ma table. Comme si je m’invitais à être heureuse. Un peu.
Et curieusement, le verbe aimer a enfin pris du sens, autour d’un petit rond de soleil.
Premier jour orangé.