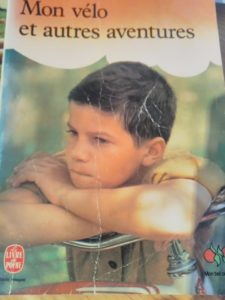On ne sait jamais vraiment à quoi ça ressemble. On peut le deviner certes. On a bien vu les pas qui se traînent, puis ne se traînent plus du tout. On a parfois entendu le souffle ténu. On a deviné les yeux qui se fermaient parce qu’ils n’avaient plus rien à regarder au-devant. Mais on ne sait jamais vraiment à quoi ça ressemble de l’intérieur. On la connaît, on la regarde, on l’accompagne parfois, pas si près que ça, la vieillesse.
J’y ai pensé d’une drôle de façon ces derniers jours. Attrapée par un covid (ou une si vous préférez), un virus – c’est certain- qui ne m’avait pas touchée depuis qu’on le connaît. Rien d’alarmant fort heureusement mais ces pas qui traînent, ce souffle plus ténu, ces yeux qui se ferment trop vite, j’y ai goûté un instant. Et j’ai pensé à la vieillesse. Celle qu’on espère vivre mais qu’on n’est jamais pressé de voir arriver. Envier une longue vie sans jamais vraiment songer à sa fin.
J’aurais pu penser à la maladie qui emporte plus tôt que prévu mais non, c’est vers la vieillesse, celle qui pousse nos vies jusqu’au bout que mon regard s’est tourné. Celle qui ralentit chaque mouvement comme si elle espérait gagner des minutes au temps, celle qui étreint les bribes de souvenirs pour essayer de rester vivante, celle qui doit souvent se demander si elle parle bien encore de nous.
Nul ne sait l’heure mais celles qui nous vieillissent comptent les pas qu’il nous reste.
J’y ai pensé. Et il y avait une immense tristesse à n’être plus qu’un corps maladroit, presque immobile, diminué de toutes ses facultés, un corps qu’on pourrait croire sans vie. Il y avait cette tristesse de n’être plus vraiment moi et en même temps, exactement en même temps oui, une immense joie à compter le temps vécu il n’y a pas si longtemps. Une plus grande joie encore, bien plus grande, à entendre toujours au loin des oiseaux de printemps, à apercevoir toujours un rayon de lumière osant encore à travers une fenêtre de pluie caresser ma main, à écouter toujours les voix familières qui racontent encore et encore la vie. Une plus grande joie à être, toujours.
Demain, je gambaderai à nouveau parce que je ne suis pas encore si vieille. J’oublierai bien vite le goût de ce temps hors-service. J’oublierai le ralenti, l’impossible, le presque rien. J’oublierai que je ne sais ni le jour ni l’heure. Je ferai encore semblant de vivre sans savoir la fin.
Mais je n’oublierai pas d’aimer la vie jusqu’au dernier souffle que Dieu me donne.